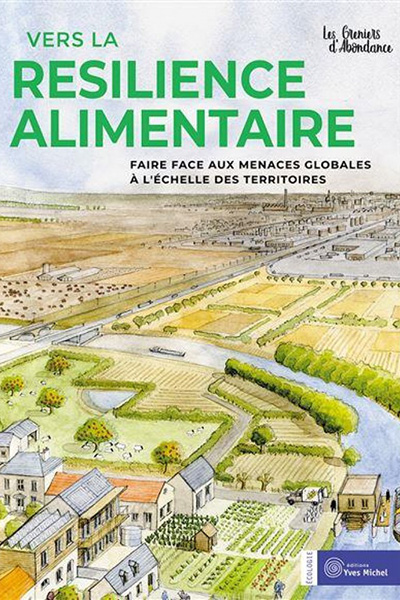Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux oiseaux (1976/1977), les premières espèces que j’ai vues sont les pics. Dans ma première semaine d’observation j’ai vu les cinq principales espèces de mon village, l’année suivante je voyais le pic cendré. Il m’est resté de cette époque-là une sorte de fascination pour ces oiseaux qui donnent l’impression d’être montés sur ressorts et semblent jouer à cache-cache avec vous.

Au niveau des observations ornithos, cette année 2021 est particulièrement riche pour moi, elle l’est encore plus au niveau photographique, le démon de la photo (et de l’affût surtout) m’ayant repris après quasiment trois années d’interruption (mis à part quelques photos d’oiseaux faites en vacances).
Conséquences de cela, je me prépare à écrire une série d’articles sur les trois espèces de pics que j’ai suivies cette année, lors de l’élevage de leurs jeunes.
Mais avant de mettre en ligne le premier article, un petit préambule sur les notions de « territoire » et de « domaine vital » qui sont deux notions différentes.
On pense que les oiseaux sont très territoriaux et défendent leur « pré-carré » becs et ongles, à coup de vocalises surtout. En fait la réalité est à nuancer. Il y a un espace proche du nid qui est effectivement défendu avec ardeur mais souvent les domaines de vie des oiseaux au sein d’une même espèce se recoupent (mêmes lieux de recherche de nourriture, même zones pour s’abreuver …) plus ou moins largement selon les espèces (je vois quatre mâle de fauvettes à tête noire qui viennent actuellement s’abreuver en même temps, alors que nous sommes en pleine période de nidification de cette espèce).
Chez les pics, ceci est encore plus vrai.
En effet, chez les pics, il faut distinguer le domaine vital et le territoire lié à la nidification. Explication : d’une part les pics sont des oiseaux sédentaires et doivent affronter des périodes difficiles, notamment en hiver (nourriture moins abondante, deux fois moins de temps la journée pour se nourrir, besoins en nourriture accrus à cause de la baisse des températures). Ils ont donc besoin d’un vaste espace, qui leur procure la nourriture suffisante pour affronter cette période difficile. Au contraire, au printemps lorsqu’il faut nourrir des jeunes oisillons tous les quarts d’heure, les adultes doivent trouver leur nourriture à faible distance du nid et ne peuvent se permettre d’aller la chercher à l’autre bout de leur espace de vie habituel. Au printemps, qui est par ailleurs une « saison d’abondance », l’espace utilisé est donc beaucoup plus restreint.
Il faut donc distinguer le territoire proprement dit, lié à la nidification, que l’oiseau défend contre l’intrusion de ses congénères, et le domaine vital, beaucoup plus vaste, qui va permettre aux oiseaux de subvenir à leurs besoins en nourriture pendant la période internuptiale (c’est à dire en dehors de la période de reproduction). Ceci est la règle générale pour tous les pics. A noter aussi que chez toutes les espèces de pics, mâle et femelle mènent une vie indépendante en dehors de la reproduction.
Deux exemples chez les pics (mais différents l’un de l’autre) pour illustrer cela :
– Chez le pic noir « le domaine vital d’un couple couvre généralement de 350 à 800 hectares, selon la qualité du milieu ambiant et notamment l’abondance de nourriture. Le territoire proprement dit, c’est à dire la zone défendue contre les congénères étrangers au couple, occupe seulement de 20 à 40 hectares autour du nid » (Michel Cuisin, 1998). Quand on voit la quantité de pics noirs présents dans certaines forêts franc-comtoises, on devine aisément que les domaines vitaux de ces oiseaux se recoupent donc assez largement.
– C’est sans doute chez le pic épeichette que la différence de surface entre domaine vital et territoire est la plus grande : « Le premier occuperait une surface moyenne de 200 à 500 hectares, le second ne ferait que quelques hectares, les parents ne s’éloignant pas à plus de 150-200 m du nid, la plupart du temps dans un rayon de 70 m ». (Pynnöyen, 1939). Par contre, dans le cas du pic épeichette, les domaines vitaux se recoupent peu et les nids sont souvent distants de plusieurs kilomètres (et effectivement, sur le terrain, on constate toujours une très faible densité de cet oiseau, qui n’est jamais abondant et dont les territoires semblent assez clairsemés).
Comme je parlerai souvent, dans les articles à venir, de domaine vital et de territoire, il me semblait utile d’amener ces précisions.