Les amoureux de musique baroque seront comblés en cette période de Noël. Après la parution récente du coffret célébrant le 50ème anniversaire des éditions Harmonia Mundi (et qui fait une large place à la musique de cette époque, voir mon article du 5 décembre), est sorti un autre très beau coffret « 200 ans de musique à Versailles » qui est un petit bijou, un véritable « voyage au coeur du baroque français ».
Les sélections choisies sont très représentatives des musiques jouées à la cour de Louis XIII, Loui XIV, Louis XV et Louis XVI. On retrouvera dans ce coffret les « très grands » que sont Rameau, Couperin, Charpentier et Lully mais aussi de nombreux compositeurs qui étaient complétement inconnus pour moi et que je découvre avec énormément de plaisir : Antoine Boesset, Robert Ballard, François Richard, François de Chancy, Michel Lambert, Jacques Champion de Chambonnières, Jean Lacquemant, Ennemond Gaultier, Pascal Colasse, Sébastien de Brossard, Henry Desmarest, François Colin de Blamont, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, Antonio Sacchini, Jean-François Lesueur, Simon Leduc … ça vous dit quelque chose tous ces noms ? Je dois avouer que si j’écoute beaucoup de musique baroque (c’est la musique que j’écoute le plus, surtout en ce moment), je ne connaissais aucun de ces compositeurs !
Il y a beaucoup de grands interprètes dans ce coffret : William Christie, Jean-Claude Malgloire, Hervé Niquet, Marc Minkowski, Véronique Gens, Andreas Staier, Jean-Paul Fouchécourt …
A acheter donc les yeux fermés et la bourse légérement ouverte car ce coffret de 20 CD ne coûte que 50 euros sur Amazon, soit 2,50 euros le CD. Ce coffret prouve une fois de plus que, quoiqu’en disent les maisons de disques, on peut aujourd’hui produire des disques à un coût bien inférieur au prix habituel.
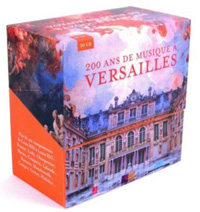
Je peux évidemment prêter les deux coffrets dont j’ai parlé aux personnes que je connais qui hésitent à acheter l’un ou l’autre. Coût du prêt : une petite bière !
Deux inconvénients toutefois à ce coffret :
– il y a un texte très intéressant de présentation des oeuvres (43 pages) + toutes les paroles des oeuvres chantées, mais uniquement sur cd en format pdf. j’aurais préféré un vrai livret sur papier.
– la durée des disques est parfois courte (deux disques font respectivement 30′ et 37′), même si la moyenne de l’ensemble est très correcte (55′ en moyenne par disque, certains dépassant les 70′).
J’avais 15, 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop.
Je n’avais aucune culture musicale, en dehors de Renaud, Capdevielle, Bashung, Couture, Cabrel que j’écoutais en boucle. Le grand orchestre du Splendid, aussi.
Je ne sais plus comment j’en suis arrivé à emprunter le disque de Lully de mon voisin d’en face (qui avait mon âge).
Ce fut un vrai coup de foudre.
J’ai passé pas mal d’année ensuite à tenter, en autodidacte, de retrouver cette émotion première en achetant, dans la mesure de mes faibles moyens, les cassettes de Monteverdi, Haendel, Purcell… produites par Harmonia Mundi.
Je crois savoir que Lully n’est pas très apprécié des critiques.
Quelle que soit la force de leurs arguments, je ne pourrais jamais les entendre totalement.
Je crois que si Lully a été très critiqué, c’est surtout parce qu’il a été le musicien officiel du royaume, qu’il a eu le monopole de la musique à Versailles et qu’il a éclipsé tous les autres musiciens de l’époque avec qui il entretenait de très mauvaises relations et de vives polémiques. J’ai l’impression qu’il est aujourd’hui un musicien beaucoup plus considéré qu’il y a vingt ou trente ans, profitant de la remise au gout du jour de la musique baroque.
J’aime aussi beaucoup Lully pour une raison plus inavouable que sa musique : dans la série des « morts stupides », malgré la forte concurrence, il est en très bonne place (dans les dix premiers je crois)
Locatelli n’a pas été insensible aux beaux chants qu’il a entendus à la messe du roi. Ne nous étonnons pas de trouver en effet à Saint-Germain-l’Auxerrois, paroisse royale, une musique particulièrement soignée. Le maître de chapelle, François Chaperon, était grand musicien, « le plus savant de son temps », a-t-on dit à sa mort. Il dirigeait une importante maîtrise et, parmi les enfants qui chantaient, un jeune garçon, fils de tailleur du quartier, avait nom Michel-Richard Delalande ; un autre, fils d’un cordonnier, s’appelait Marin Marais. Ils étaient âgés de huit et neuf ans lorsque Locatelli entendit la messe du roi, et ils devaient en être…
Tel qu’on connaît Louis XIV, son goût pour la musique et surtout son habitude de s’intéresser en ce domaine à tous les détails pratiques de l’exécution, il n’y aurait rien d’étonnant à ce qu’il ait connu l’existence de ces deux enfants musiciens, l’un et l’autre reconnus dès cet âge comme des enfanst prodiges. Le petit Delalande chantait déjà en solo. A partir de 1683, il prendra la tête de la musique de la chapelle de Versailles, puis de la surintendance, et cumulera presque toutes les grandes charges musicales de la cour. Il racontera lui-même les moments où Louis XIV venait le voir travailler et discutait pièce par pièce ses compositions. L’autre, Marin Marais, deviendra le grand virtuose de la viole, « ordinaire de la musique du roi », « batteur de mesure » de l’opéra, et jouera dans la chambre du roi, avec ses propres fils. Tous deux furent parmi les plus grands compositeurs de leur génération, et furent peut-être les plus grands. Tous deux aussi parmi les musiciens qui eurent, sur les vieux jours du roi, le plus de réelle intimité avec lui.
En 1709, alors que le petit chanteur est devenu l’un des plus grands musiciens de son temps, à cinquante-cinq ans, Marin Marais vient présenter ses fils au roi, qui en a soixante-dix. Ils lui font ensemble un petit concert en quatuor, tandis que le plus jeune range les partitions et les range sur les pupitres. « Le roi entendit ensuite ses trois fils séparément et lui dit : « Je suis bien content de vos enfants, mais vous êtes toujours Marais leur père »… »
Deux ans plus tard, lors de la terrible épidémie qui fit mourir coup sur coup le Grand Dauphin (Monseigneur), le duc de Bourgogne et toute la descendance du Roi-Soelil, à l’exception du petit Louis XV, Delalande perdit lui-aussi ses deux filles, merveilleuses chanteuses, qu’il chérissait. « Vous avez perdu deux filles qui avaient bien du mérite ; moi j’ai perdu Monseigneur. » Et le chroniqueur ajoute : « Et lui montrant le ciel, le roi ajouta : « Lalande, il faut se soumettre ». »
On a souvent souligné l’infidélité de Louis XIV : aux femmes, bien sûr (sauf à la dernière), aux artistes (Lully, Molière…). Quelquefois, au contraire, les années passaient et le retrouvaient, amical, paternel, délicat, touchant même.
(Le Roi-Soleil se lève aussi, Gallimard, 2000)
Etonnant que les trois compositeurs cités dans cet extrait ne fassent vraisemblablement pas partie du coffret, non ?
Et que la cour de Louis XIII soit associée à Versailles, aussi.
Pour bien comprendre la musique de cette époque, il faut parvenir à imaginer la place centrale qu’occupait alors la danse. On dansait tous les jours, par exemple, à la cour de Louis XIV, et le roi lui-même mena même pendant près de vingt ans, une carrière de danseur virtuose.
Si l’après-midi n’est pas occupé par la chasse ou par la promenade, le roi danse : du moins le fera-t-il jusqu’en 1670, l’hiver surtout, quand se préparent pour le carnaval les représentations de ballets de cour. Aux XVIIe siècle, on appelle cela « divertissement », mais nous ferons erreur si nous donnons à ce mot le sens qu’il a pour nous d’amusement, de distraction, de récréation. En décembre, en janvier, en février encore, cette occupation devient préoccupation. Elle est quotidienne et à mesure que l’on s’approche du soir de la « première », l’animation, l’agitation, l’effervescence vont croissant.
Comment imaginer aujourd’hui – à une époque qui se croit drôle et se veut, comme elle dit, « libérée », mais qui ne semble pas gaie dans les alentours du pouvoir -, comment concevoir que, parce qu’on va danser, le château de Saint-Germain ou le palais du Louvre se transforment en ruche et se trouvent ainsi chaque hiver, agités d’un branle-bas général, d’un va-et-vient chaque jour plus fiévreux, de maîtres-à-danser et de grands seigneurs répétant leur rôle, de costumières et de princesses fourbissant leurs atours et affinant leurs entrechats, dans une agitation au moins égale aux grands jours d’effervescence (quand la cour s’en va en Flandre, et que trois mille personnes font leurs bagages) ou aux grands moments de la politique ou de la guerre ?
C’est pourtant bien ainsi qu’il faut se représenter les choses : les documents le disent, entre leurs lignes sèches. Ils nous affirment qu’on répète le ballet pendant deux mois, que vers la fin il y a trois répétitions par jour, dédoublées parfois en plusieurs lieux du château, qui s’est rempli de répétiteurs et de violons brusquement promus maîtres de l’emploi du temps et du protocole. A l’exception de la messe, tout plie : lever, dîner, coucher, cérémonial. Enfin presque tout… (…)
Mais nous n’aurons rien compris à la nature de ce grand branle-bas, si nous ne mesurons pas ce que l’acte même de danser signifie pour un homme du XVIIe siècle, et ce que Louis XIV, toujours semblable à lui-même en cela comme dans le reste, a su faire en se plaçant au centre de ce que ses sujets aimaient par-dessus tout. Il l’a pourtant écrit dans ses Mémoires, ce texte qu’on ne lit jamais sous prétexte que c’est sans doute Pélisson qui l’a rédigé, alors qu’il livre tant de secrets : « Un prince, et un roi de France, peut encore considérer quelque chose de plus dans les divertissements publics, qui ne sont pas tant les nôtres que ceux de notre cour et de tous nos peuples. Il y a des nations où la majesté des rois consiste, pour une grande partie, à ne se point laisser voir, et cela peut avoir ses raisons parmi les esprits accoutumés à la servitude, et que l’on gouverne par la terreur ; mais ce n’est pas dans le génie de nos Français et, d’aussi loin que nos histoires nous le peuvent instruire, s’il y a quelque chose de singulier dans cette monarchie, c’est l’accès libre et facile au prince. »
« Ne se point laisser voir » : il pense à l’Espagne, bien entendu. C’est ce qu’il ne veut pas. « Se faire voir » au coeur de ce que ses « peuples » aiment à voir, c’est ce qu’il veut et c’est ce qu’il a fait. Cela supposait qu’il fût le meilleur danseur, et il le fut.
(Le Roi-Soleil se lève aussi, Gallimard, 2000)
Richelieu raconte dans ses Mémoires que le duc de la Rochefoucauld, ayant été choisi par lui pour aller négocier en Espagne (et il précise : « à ma place » ; ce n’était pas un voyage d’agrément), refusa « d’autant qu’il était engagé dans un ballet qu’il voulait danser ». Ainsi, dans ce curieux temps, le roi travaille ses entrechats à s’en rende malade et le duc refuse une ambassade pour se pavaner. Ces gens sont-ils si futiles ? N’en croyez rien.
Les Jésuites, qui sont gens sérieux, et qui ont mis au point l’une des plus géniales organisations pédagogiques de tous les temps, enseignaient la danse dans leurs collèges, à côté du latin, de l’éloquence et de l’histoire. Il y attachaient tant d’importance qu’ils faisaient pour cela appel aux plus grands virtuoses. Pour peu qu’on connaisse la philosophie didactique des messieurs de la Compagnie, cela signifie que la danse était alors comprise comme l’un des plus parfaites démonstrations possibles de la qualité d’homme, et même d’ « honnête homme ».
Dans la danse, écrit l’abbé de Pure (des Jésuites, un abbé… Curieux temps…), « vous paraissez tel que vous êtes, et toutes vos actions sont tributaires aux yeux des spectateurs, et leur exposent et le bien et le mal dont l’Art et la Nature ont favorisé ou disgracié votre personne. Ainsi le bal mérité bien quelque sorte de soin, et qu’un galant homme s’applique à se bien tirer d’un pas si dangereux ».
(Le Roi-Soleil se lève aussi, Galimard, 2000)
Comprenons bien. La danse ne peut être pour nous, aujourd’hui, que deux choses, parfaitement opposées l’un à l’autre. Ou bien c’est un art difficile, auquel des hommes et des femmes consacrent leur vie, leur corps, leur pensée, afin d’atteindre une virtuosité à laquelle aucun d’entre nous ne saurait prétendre, et qu’ils nous exposent dans des théâtres. Ou bien elle est un divertissement sans conséquence auquel on se livre entre amis et auquel on prend plaisir, le samedi soir, sans se flatter d’en faire une œuvre d’art. Ni l’un ni l’autre ne correspond à la nature et à la fonction qui étaient les siennes au temps du Roi-Soleil, et que laisse entrevoir l’abbé de Pure. Elle s’inscrit elle-même, comme il le suggère, dans une manière de concevoir l’homme. L’ « honnête homme », c’est un homme, en mieux. L’ « honnêteté » est un perfectionnement, un achèvement, un « polissage » (poli veut dire parfait : du marbre poli, c’est du marbre enfin achevé) de l’humain. Il est humain de parler : il est mieux d’être éloquent. L’éloquence est un langage « poli ». Il est heureux d’être né beau et bien fait, mais il est mieux d’être « paré ». La « parure » est au-delà de la nature. Nous pensons aujourd’hui le contraire : nous aimons ce qui nous paraît « naturel » (et qui d’ailleurs ne l’est pas forcément), simple et direct. C’est notre façon de voir ; nous devons admettre que d’autres temps ont pensé autrement et ont préféré ce qui est « poli » à ce qui est « naturel ». Nous devons accepter qu’à de certaines époques on a pu penser qu’il était plus parfait et plus achevé d’avoir une perruque que de simples cheveux. De même, on a pensé que marcher, agir, faire des mouvements et des gestes, cela est humain ; mais que bien marcher, avec grâce, donner de l’harmonie à son maintien et à ses attitudes, c’est mieux : c’est une nature « parée ». Danser, c’est aller encore plus loin et parvenir avec ses membres et tout son corps au sommet de la grâce et de l’harmonie. La danse est donc, pensait-on, la perfection de la nature, qui nous a fait don du mouvement, comme l’éloquence est la perfection de la parole. C’est bien pourquoi les Jésuites enseignaient conjointement l’éloquence et la danse.
Et c’est pourquoi un roi de France peut s’appliquer et même « au point de s’en rende malade » à paraître publiquement comme le plus brillant danseur de son royaume. Il ne sort pas de sa fonction plus qu’il ne le fait dans les autres domaines de la représentation de sa personne. On pourrait, sans forcer, affirmer que bien danser est son devoir de roi. Louis XIV l’a compris ainsi, et aussi ses sujets, qui se pressent pour le voir, si l’on en croit la Gazette où Loret se plaint d’avoir failli mourir écrasé.
(Le Rois-Soleil se lève aussi, Gallimard, 2000)
Pour expliquer mon allusion plus haut (à la mort « con » de Lully) : il est mort, je crois, d’une gangrène suite à un coup qu’il se serait mis lui même sur le pied avec le bâton qui servait à l’époque au chef d’ochestre pour battre la mesure.
Le ballet est, depuis en tout cas la fin du XVIe siècle, un des moments clefs de la vie de la cour. Henri III, Henri IV, LOuis XIII s’y sont adonnés avec passion – et ce dernier surtout, qui composait la musique, la chorégraphie des entrées, réglait la mise en scène et dessinait les costumes. La partition du Ballet de la merlaison qu’il a composé et dont il a tout réglé, nous est parvenue : elle n’est pas indigne…
(Le Roi-Soleil se lève aussi, Gallimard, 2002)